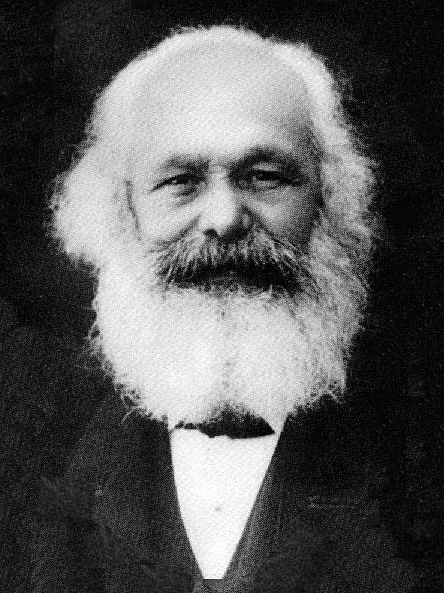Alexis Cukier est venu à Poitiers le jeudi 2 avril parler au nom du regroupement national « avec les Grecs ».
Le texte de l’ intervention qu’il fit devant environ 80 personnes dans les locaux de la Ligue de l’enseignement recoupe l’article qui vient de paraitre sur le site d’Ensemble, sous sa signature et celle de Pierre Khalfa.
https://www.ensemble-fdg.org/content/grece-lheure-des-choix/
A la suite de cette intervention le Collectif pour un audit citoyen de la dette est relancé à Poitiers.
Voici de larges extraits de cet article:
Alexis Tsipras « doit faire atterrir ses troupes et que Syriza redescende sur terre ». Ainsi s’exprime le ministre des Finances et des Comptes publics Michel Sapin[1]. Cette phrase est un condensé politique. Elle combine le mépris à l’égard de la Grèce et de Syriza. Mépris, quand le peuple grec est comparé à des militaires aux ordres d’un chef. Incapable donc de réfléchir par lui-même, il faut le faire « atterrir ». Renoncement à tout projet de transformation sociale avec l’injonction faite à Syriza de « redescendre sur terre ». Pour ceux qui avaient l’illusion que le gouvernement français pouvait avoir une attitude bienveillante envers le gouvernement grec, cette déclaration, après l’attitude hypocrite de la France lors des réunions de l’Eurogroupe, sonne la fin des illusions. La Grèce est dramatiquement seule.
Le programme de Syriza et le premier accord avec l’Eurogroupe
 La position du gouvernement grec dans les négociations en cours ne peut être comprise sans rappeler trois facteurs politiques déterminants : les dégâts économiques et sociaux causés par la « cure d’austérité » imposée par la Troïka, le programme de Syriza et le nouvel équilibre des forces politiques en Grèce après les élections du 25 janvier 2015.
La position du gouvernement grec dans les négociations en cours ne peut être comprise sans rappeler trois facteurs politiques déterminants : les dégâts économiques et sociaux causés par la « cure d’austérité » imposée par la Troïka, le programme de Syriza et le nouvel équilibre des forces politiques en Grèce après les élections du 25 janvier 2015.
Le mandat du gouvernement est d’abord de rompre avec la logique qui a conduit à l’appauvrissement absolu de la population grecque depuis 2010 et de répondre à une crise humanitaire sans précédent ces dernières décennies en Europe.[2] En moins de cinq ans, 30% des entreprises grecques ont fermé, 150 000 postes ont été supprimés dans le secteur public, il y a eu 42% d’augmentation du chômage, 45% de baisse des retraites, une hausse de près de 100% des personnes sous le seuil de pauvreté. Le PIB a diminué de 25% et la dette publique est passée de 120% à 175% du PIB. En 2014, le taux de chômage atteignait 27 % – plus de 50 % pour les jeunes – et le salaire minimum était de 480 euros net. C’est à cette aune qu’il faut mesurer l’adhésion suscitée par le projet de Syriza d’en finir avec les pratiques politiques de capitulation sans coup férir devant les desiderata d’institutions européennes envoyant leurs ordres par courrier électronique[3] ainsi que l’hostilité massive du peuple grec envers le plan européen d’ « aide » financière dont l’essentiel a servi à renflouer les banques européennes en particulier allemandes et françaises.[4]
Le programme de Syriza visait précisément à mettre un terme à cette situation. Il prévoyait quatre points : une renégociation des contrats de prêts et de la dette publique ; un plan national de reconstruction immédiate : mesures pour les plus pauvres, rétablissement du salaire minimum, réinstauration des conventions collectives ; la reconstruction démocratique de l’État : lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, contre la corruption, réembauche des fonctionnaires licenciés ; un plan de reconstruction productive : arrêt des privatisations, industrialisation et transformation de l’économie par des critères sociaux et écologiques. C’est ce programme qui a obtenu lors des élections du 25 janvier 36,34 % des suffrages, qui a constitué les termes de l’alliance de Syriza avec les « Grecs indépendants »[5], et qui continue de former le socle du soutien massif du peuple grec au nouveau gouvernement. Et c’est à la mise en œuvre progressive de ce programme qu’Alexis Tsipras s’est engagé dans son discours de politique générale et de présentation du projet gouvernemental au nouveau Parlement grec le 8 février dernier[6].
Il s’agit, on le voit, d’un programme relativement modéré, d’inspiration keynésienne. Pourtant, les classes dirigeantes européennes ont fait bloc pour s’y opposer car, même modeste, il entre en contradiction frontale avec l’ordre néolibéral patiemment construit depuis une trentaine d’années. Traité européen après traité européen, directive après directive, l’Union européenne est devenue une machine juridique dont l’objectif est d’empêcher tout débat démocratique réel, d’exclure de la décision citoyenne les politiques économiques et sociales et de museler ainsi la souveraineté populaire. Les politiques économiques se réduisent à appliquer une série de normes, impératifs catégoriques sur lesquels les peuples n’ont rien à dire. C’est cette construction que la victoire de Syriza remet en cause et c’est pourquoi il faut que ce programme soit mis en échec. C’est cela que vise la stratégie adoptée par les institutions dans les négociations en cours depuis mi-février, ce qu’on appelle en Grèce « la parenthèse de gauche » : organiser l’effondrement de Syriza dans les mois suivant son élection.
Commençons par rappeler le contenu des accords entre Syriza et l’Eurogroupe à ce jour. Sous la pression d’un ultimatum lancé par l’Eurogroupe le lundi 16 février, le gouvernement grec signe un accord de principe le vendredi 20 février. Le prolongement de l’aide financière y est conditionné à la validation d’une liste de réformes que le gouvernement grec a du proposer en toute hâte le lundi 23 février et qui a été accepté sur le principe par l’Eurogroupe le mardi 24 février. On peut résumer ainsi le contenu de ces deux textes[7]. Le communiqué de l’Eurogroupe du 20 février prévoit le prolongement provisoire du programme précédent, confirme l’objectif du remboursement de l’intégralité de la dette ainsi que celui d’un excédent primaire devant être « en ligne » avec l’objectif de 4,5% en 2016. Il engage le gouvernement grec à « ne pas revenir sur des mesures et à n’effectuer aucun changement unilatéral de politique ou de réformes structurelles qui impacteraient négativement les objectifs budgétaires, la croissance économique et la stabilité financière. ».
La liste des réformes envoyée par le gouvernement grec le 23 février est organisée autour de quatre points : 1. La réforme des politiques fiscales : elle prévoit la mise en place d’instruments à grande échelle, inédits, pour contrer la fraude fiscale et la corruption, mais aussi la poursuite de l’austérité (notamment concernant la santé, les salaires et les retraites) et des concessions au credo néolibéral (revenus et évaluation individualisés, maximisation de la mobilité des ressources humaines, etc.). 2. La stabilité financière : elle prévoit de dépénaliser l’endettement des personnes à faible revenu et de ne pas exproprier les petits propriétaires endettés de leur résidence principale mais aussi l’engagement à payer l’intégralité de la dette ainsi que l’attribution des 10 milliards d’euros du Fonds Hellénique de Stabilité Financière non pas au budget de l’État comme le défendait le gouvernement grec mais seulement pour la recapitalisation des banques 3. La promotion de la croissance : elle prévoit des instruments de lutte contre le chômage et n’évoque pas de nouveaux licenciements comme l’exigeaient les projets initiaux de la Troïka, mais aussi la poursuite des privatisations, le report de l’augmentation du salaire minimum et de la restauration des négociations salariales, la promotion de la compétition et l’ouverture au capital des professions réglementées. 4. La crise humanitaire : le principe de mesures d’urgence (bons d’alimentation, aides concernant la santé et l’énergie pour les ménages aux plus faibles revenus) contre la grande pauvreté est validé, le projet d’un revenu minimum garanti est évoqué, mais il est stipulé que ces mesures ne doivent pas avoir « d’effet fiscal négatif », c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir de coût budgétaire.
De nombreuses analyses ont proposé des évaluations immédiates du contenu de ces accords des 20 et 24 février, en insistant tantôt sur les reculs de Syriza par rapport au programme de Thessalonique tantôt sur les reculs des institutions européennes par rapport au projet de mémorandum initialement envisagé.[8] Mais si la séquence politique de cette négociation se déroule à un rythme extrêmement dense et accéléré, il ne s’agissait là que du premier round du bras de fer opposant la stratégie de « la parenthèse de gauche » à ce qu’on peut appeler la stratégie de la « désobéissance contrôlée »[9] du gouvernement grec. En effet, aussitôt cet accord signé, le gouvernement conduit par Alexis Tsipras comme les institutions européennes ont cherché à garder la main sur l’interprétation de cet accord ainsi que sur le calendrier du bras de fer politique.
Le début d’un affrontement prolongé
Du côté de la Vouli, le Parlement grec, on retiendra quatre initiatives importantes. D’abord, dès les premiers jours suivant la formation du gouvernement, la vice-ministre des politiques migratoires, Tasia Christodoulopoulou, a annoncé que le droit du sol remplacerait enfin en Grèce le droit du sang, permettant ainsi que 200.000 enfants d’immigrés obtiennent la nationalité grecque, ainsi que la fermeture de tous les centres de rétention de migrants en Grèce. Rappelons que le règlement européen Dublin II prévoit que les pays du sud de l’Europe, et notamment la Grèce, jouent le rôle de frontière répressive dans la « forteresse Europe ». Au-delà de ces premières mesures, la Grèce devrait faire entendre dans l’Union européenne une voix différente sur les questions d’immigration, en dénonçant notamment ce règlement et la logique de la politique migratoire qui le sous-tend.
Ensuite, dans l’immédiat après-coup des premiers accords avec l’Eurogroupe, le ministère de la lutte contre la corruption annonce la saisie de plusieurs centaines de millions d’euros sur des comptes bancaires de déposants riches ne pouvant justifier fiscalement leurs actifs, montrant ainsi sa détermination à mettre en œuvre effectivement, à la différence des gouvernements précédents, une des exigences majeures de l’Eurogroupe, qui constituait également une mesure phare du programme de Thessalonique. Un des principaux slogans mis en avant par le cabinet de Tsipras exprime ainsi très clairement cette orientation : « Rupture avec la caste[10], solution avec l’Europe ». Puis, le 17 mars, Zoé Konstantopoulou, la présidente du Parlement grec annonce la constitution d’une commission d’audit de la dette publique grecque, qui est coordonnée par Eric Toussaint (porte parole du CADTM International)[11] et dont l’objectif explicite est de « déterminer l’éventuel caractère odieux, illégal ou illégitime des dettes publiques contractées par le gouvernement grec ». Il s’agit d’un signal fort envoyé à la Troïka : le gouvernement est toujours déterminé à négocier une annulation partielle de la dette du pays. Enfin, le 18 mars, le gouvernement fait adopter la première loi de sa mandature, consacrée à un ensemble de mesures sociales en faveur des plus pauvres. Elle prévoit notamment de fournir l’électricité gratuite et une aide au logement pour les foyers les plus démunis, d’accorder une aide alimentaire pour 300 000 personnes, ainsi qu’une aide financière pour toutes celles et ceux qui sont privés de sécurité sociale par la perte de leur emploi.
Comme il était prévisible, ces quatre séries de mesures ont suscité des réactions de mauvaise foi, de mépris et de rejet de la part de l’Eurogroupe et ont contribué au durcissement, de part et d’autre, de la tonalité des négociations ces deux dernières semaines. La réaction des institutions européennes à l’annonce des mesures de lutte contre la corruption et la fraude fiscale est révélatrice de leur attitude à l’égard du gouvernement grec. Plutôt que de proposer une coopération à l’échelle européenne – qu’Alexis Tsipras a donc initié, sans l’appui de l’Union européenne, avec l’OCDE, institution qui n’est pas particulièrement connue pour son gauchisme, mais dont les préconisations insistent utilement sur l’évasion fiscale internationale – en vue de poursuivre les exilés et délinquants fiscaux (dont une partie se trouvait pourtant sur la « liste Lagarde »[12]), les institutions européennes ont répondu par une demande accrue de contrôle des services administratifs et financiers à Athènes. Il s’agit notamment d’éviter que soient remises en cause les pratiques de concurrence et « d’optimisation » fiscales par ailleurs encouragées par ces mêmes institutions ainsi que de continuer à faire peser la responsabilité de cette fraude fiscale sur les contribuables grecs (dont on rappellera au passage que les impôts sur le revenu sont prélevés à la source…).
D’autre part, les représentants des institutions européennes se sont abstenus de tout commentaire sur la commission d’audit de la dette publique, mais ont fait à nouveau planer, ces derniers jours, la menace d’une sortie de la Grèce de la zone euro. Enfin, l’annonce de l’adoption prochaine de la loi anti-pauvreté à la Vouli a valu à Alexis Tsipras un mise en garde[13] du directeur général de la direction des affaires économiques et financières de l’équipe européenne en charge de la « supervision » technique des réformes en Grèce, Declan Costello, au motif que cette loi constituerait une « action unilatérale » formellement prescrite par l’accord du 24 février.[14] Dans un deuxième temps, la Commission européenne a finalement débloqué 2 milliards d’euros en soutien à la « cohésion sociale » en Grèce, tout en continuant d’exiger une nouvelle liste de « réformes structurelles ».
La nouvelle liste des réformes : la bataille continue
C’est autour de cette deuxième liste de réformes qu’a désormais lieu le deuxième round du bras de fer entre le gouvernement grec et l’Union européenne. Toujours sous la pression du calendrier imposé par le feu croisé des échéances de remboursement et des ultimatums politiques de l’Eurogroupe, le gouvernement grec a présenté mercredi 1er avril au « Groupe de Bruxelles » (Commission européenne, Fonds monétaire international et BCE, auxquels s’est désormais ajouté le Fonds européen de stabilité financière) une nouvelle liste de réformes que cette dernière exige de valider avant de débloquer une dernière tranche d’aide du plan européen, soit 7,2 milliards d’euros.
Cette liste de réformes prévoit notamment une séries de mesures permettant d’améliorer les rentrées fiscales de la Grèce (nouveau système de collecte d’impôt, mesures complémentaires de lutte contre l’évasion fiscale), la vente de licences de radiodiffusion, un relèvement du taux supérieur d’imposition sur le revenu ainsi que certains taux de TVA sur les produits de luxe et les boissons alcoolisées, ainsi que la poursuite de certaines privatisations (notamment du Port du Pirée). Dans l’ensemble, cette liste ne fait que préciser et prolonger celles déjà présentées le 23 février, puis le 6 mars.
Mais elle ne prévoit pas les réformes du marché du travail et le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite (à 67 ans) explicitement exigés par l’Eurogroupe. Or ce nouveau point d’achoppement des négociations concerne le noyau dur de la politique économique qui sera menée dans les prochaines années en Grèce, si bien que le bras de fer s’est à nouveau durci ces derniers jours. Pour les institutions européennes, il s’agit de s’assurer de la poursuite des « réformes structurelles » et de faire jouer la pression des échéances de remboursement afin de forcer le consentement du gouvernement aux politiques néolibérales refusées par Syriza. Les termes du chantage sont assez explicites : il s’agit d’espérer que la Grèce soit en un défaut de paiement lors du prochain remboursement au FMI, prévu le 9 avril[15]. Le gouvernement grec étant alors aux abois, il n’aurait pas d’autre choix, pour faire débloquer une nouvelle tranche d’aide permettant ce remboursement, que d’accepter les conditions posées par l’Eurogroupe. A ce chantage, Nikos Voutsis, ministre de l’Intérieur et de la reconstruction administrative, vient de répondre de manière ferme : l’État grec paiera d’abord les salaires et les pensions, et ensuite seulement, si c’est possible, le remboursement au FMI. Pour le gouvernement grec, il s’agit de rester dans le cadre des accords de février en évitant de dépasser les « lignes rouges » qui empêcheraient la mise en œuvre d’une politique économique alternative.
Dans cette optique, il est nécessaire de continuer les réformes sur le front intérieur et de trouver des leviers politiques dans la négociation avec le « Groupe de Bruxelles ». Ainsi, le gouvernement grec a dû confirmer la privatisation du port du Pirée au bénéfice de la société chinoise Cosco, ce qui a amené Pékin à acheter 100 millions de bons à court terme, appelés T-Bills, émis par l’État grec (voir plus loin sur cette question). D’autre part, le gouvernement grec a avancé une rencontre officielle avec le gouvernement russe, qui pourrait proposer à la Grèce une aide économique en échange d’un soutien géopolitique dans son conflit avec l’OTAN ainsi que pour le projet du gazoduc Turkish Stream. Cette rencontre a été planifiée le 8 avril, c’est-à-dire la veille de l’échéance de remboursement au FMI précédemment mentionné. En réaction, l’Eurogroupe continue de jouer la montre : les derniers échos de Bruxelles évoquent l’impossibilité d’un accord avant fin avril. Autrement dit, il s’agit d’attendre que la crise de liquidités de l’État grec s’aggrave en espérant que cela soit suffisant pour faire céder Syriza. La « guerre de position » continue, et il est fort difficile d’imaginer ce qui pourra débloquer la situation sans aggraver le conflit politique.
Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle situation de blocage, il est nécessaire de préciser l’analyse de la stratégie d’étranglement adoptée par les institutions européennes ainsi que le dilemme tactique qui se pose aujourd’hui au gouvernement grec.
La stratégie de l’étranglement
L’attitude des dirigeants européens peut donc être résumée de la façon suivante : soit l’acceptation par la Grèce de la politique définie par l’Eurogroupe, soit la sortie de l’euro. Le moyen utilisé, c’est l’étranglement financier. Rappelons-en les principaux épisodes.
Début février, soit quelques jours à peine après la victoire de Syriza, la Banque centrale européenne (BCE) annonce qu’elle cesse d’accepter les titres public grecs comme garanties (collatéraux) lors des opérations de refinancement des banques grecques. Ces dernières peuvent certes continuer à bénéficier de l’accès à l’aide à la liquidité d’urgence (ELA), mais outre que le taux d’intérêt est beaucoup plus élevé (1,55 % contre 0,05 %), cet accès peut être coupé à tout moment par la BCE. De plus, celle-ci refuse de débloquer 1,9 milliard correspondant aux intérêts qu’elle a engrangés sur les titres grecs qu’elle possède[16]. L’Eurogroupe refuse de verser à la Grèce la dernière tranche de prêts (7,2 milliards d’euros) prévue dans le cadre de l’accord du 20 février 2015, attendant que la liste des « réformes » proposées par le gouvernement grec le satisfasse.
Fin mars, la BCE demande aux banques grecques de ne plus acheter les titres publics émis par l’État grec. Or sans apport financier extérieur, le financement de l’État grec ne repose aujourd’hui que sur la capacité des banques grecques à acheter des bons du trésor à court terme (T-Bills). La BCE avait auparavant déjà refusé la demande du gouvernement grec de relever le plafond d’émission des T-Bills de 15 à 25 milliards d’euros. Elle veut en interdire maintenant l’achat par les banques grecques. La Grèce est donc, de fait, privée de source de financement. Dans le même temps, les directeurs du Trésor des pays de la zone euro ont refusé de restituer à la Grèce 1,2 milliard d’euros lui revenant[17]. La Grèce risque donc de se trouver en situation de cessation de paiement dès le 20 avril.
Comble du cynisme, la BCE a commencé, dans le cadre d’une opération dite de Quantitative Easing (QE), à acheter sur le marché secondaire, c’est-à-dire aux banques les possédant, des titres publics des États[18]. Mais, elle n’achètera que les emprunts publics les mieux notés, sauf si le pays accepte un programme d’aide du FMI, c’est-à-dire se soumet à la purge sociale que sont les réformes structurelles. La Grèce, pays qui aurait pourtant le plus besoin de bénéficier de ces rachats d’emprunts, n’y aura donc pas droit sauf si elle accepte de continuer à se soumettre au diktat des institutions européennes. La BCE ne laisse le choix qu’entre la ruine financière et la dévastation sociale.
Cette stratégie d’étranglement vise un objectif principal : que le gouvernement grec finisse par accepter des réformes, ou plutôt des contre-réformes, que même le gouvernement précédent avait refusées, notamment en matière de retraite et de marché du travail. Il s’agit de faire capituler Syriza ou, en cas de refus, de forcer la Grèce à sortir de l’euro. Comme il est impossible juridiquement d’expulser un pays de la zone euro et qu’une volonté affichée de le faire créerait probablement des tensions entre les gouvernements de l’Union européenne, il s’agit, en l’étranglant, de forcer la Grèce à prendre l’initiative de cette sortie. Le gouvernement grec est parfaitement conscient du dilemme dans lequel le « Groupe de Bruxelles » veut l’enfermer. C’est pourquoi il cherche un compromis afin d’essayer de briser cet étau. Mais tout compromis renvoie aux rapports de forces entre les parties. Or le gouvernement grec n’a pas réussi à diviser ses adversaires et la faible mobilisation citoyenne européenne en sa faveur n’a pas permis de peser sur les orientations des gouvernements européens.
Les dirigeants européens préfèreraient évidemment que le gouvernement grec revienne sur ses engagements électoraux. Une telle capitulation serait utilisée pour démontrer aux autres peuples d’Europe qu’aucune alternative n’est possible et que même un gouvernement de la gauche radicale est obligé d’être « raisonnable ». C’est ce que nous avons précédemment évoqué sous la rubrique de la stratégie de la « parenthèse de gauche ». Mais, malgré une situation dramatique, Syriza tient bon sur l’essentiel. Continuer l’étranglement de la Grèce pour l’obliger à sortir de l’euro reste donc une option. Ainsi, interrogé par la télévision publique autrichienne ORF sur la possibilité d’un « Grexident » (contraction entre « Grexit », terme renvoyant à une sortie de la Grèce de la zone euro, et accident), Wolfgang Schäuble, le ministre des finances de l’Allemagne, a estimé jeudi 12 mars que, « dans la mesure où la Grèce seule a la responsabilité, la possibilité de décider ce qui se passe, et comme nous ne savons pas exactement ce que les responsables grecs font, nous ne pouvons pas l’exclure ».
Il a certes été démenti et les déclarations officielles se multiplient pour affirmer que la Grèce doit rester dans l’euro. Au-delà des effets de communication, il y a un vrai dilemme pour le « Groupe de Bruxelles ». Les institutions et les gouvernements européens ont parfaitement compris l’enjeu de la situation : un succès de Syriza remettrait en cause 30 ans de néolibéralisme en Europe et risquerait d’entraîner une contagion dans toute l’Europe à commencer par l’Espagne avec Podemos. Pour les plus extrémistes des dirigeants européens, tout, même une sortie de la Grèce de l’euro, serait préférable à ce scénario catastrophe. La question peut ainsi être résumée : le meilleur scénario de capitulation de Syriza doit-il avoir lieu en dehors ou dans le cadre de l’eurozone ?
Or, les partisans d’un « Grexident » peuvent en effet penser que du fait du faible poids économique de la Grèce et du fait que les banques grecques ne sont pas systémiques, le risque de déstabilisation de la zone euro serait réduit, ce d’autant plus que la politique de QE menée par la BCE permettrait de limiter les risques de spéculation financière sur les États les plus exposés. De plus, les créances de la Grèce étant déjà comptabilisées dans les dettes publiques des États, un éventuel défaut n’aurait pas de conséquences sur le niveau des ces dernières. Mais, en fait, il est impossible de prévoir réellement les conséquences d’une sortie de la Grèce de l’euro. En remettant en cause l’irréversibilité de l’euro, c’est également la croyance au caractère irrévocable de l’Union économique et monétaire qui serait détruit. Des interrogations inévitables se feraient jour pour les pays les plus fragiles avec une probabilité d’un accroissement des primes de risque pour ces pays. Enfin, le crédit de la BCE qui, par la voix de Mario Draghi, avait promis en juillet 2012 que « La BCE est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour préserver l’euro » serait entamé. Rien de pire pour une banque centrale !
Jusqu’à présent, les dirigeants européens ont fait bloc en estimant que le gouvernement grec allait céder face à l’étranglement financier. La prise en compte des risques de cette stratégie provoquera-t-elle des divisions parmi les gouvernements européens si, Syriza ne capitulant pas, la perspective d’une sortie de l’euro devient imminente ?
(…)
La Grèce a des marges de manœuvres
Contrairement aux apparences, la Grèce n’est pas dépourvue de marges de manœuvres dans son affrontement avec les dirigeants européens à la condition de reprendre l’initiative pour éviter de subir les rapports de forces actuels dans le cadre de négociations déséquilibrées. Le débat à l’intérieur de Syriza est vif sur ce sujet et dépasse largement l’affrontement traditionnel entre partisans et adversaires de la sortie de l’euro. Le gouvernement grec pourrait notamment prendre un certain nombre de mesures unilatérales sortant du cadre des négociations actuelles, ce qui permettrait de rétablir un certain équilibre entre les parties. Certes, ces initiatives unilatérales durciraient notablement le bras de fer actuel, mais elles montreraient que la Grèce a un plan B et est prête à assumer un affrontement pouvant aller jusqu’à la rupture.
Ces mesures unilatérales, pour n’en rester ici qu’à la dimension économique, pourraient être de plusieurs ordres. Le premier concerne la question de la dette[22]. En général, un État ne rembourse jamais vraiment sa dette : lorsque les titres arrivent à échéance, il emprunte de nouveau sur les marchés financiers. Mais la Grèce qui n’a plus accès aux marchés financiers est obligée, non seulement de payer les intérêts de sa dette, mais aussi de rembourser le principal. C’est pourquoi les dirigeants européens exigent que ce pays dégage un fort excédent budgétaire primaire (hors du paiement des intérêts de la dette) pour pouvoir rembourser avec ses ressources propres tout ou partie du principal. Ainsi, pour la Troïka, la Grèce doit dégager un excédent primaire de 3 % du PIB en 2015 (la Grèce a obtenu que ce chiffre soit modulé en fonction de la situation économique), de 4,5 % en 2016 et 2017 et de 4,2 % jusqu’en 2020. Une telle perspective entrainerait de nouvelles coupes drastiques dans les budgets publics et serait un obstacle majeur à toute politique publique en matière d’investissement. Le poids de la dette est donc un obstacle à toute politique progressiste dans le pays. Or le « Groupe de Bruxelles » refuse pour le moment toute renégociation de ce fardeau, alors même que la quasi totalité des économistes, y compris ceux du FMI, pense que cette dette ne sera jamais remboursée. Or 2015 est une année où les remboursements seront particulièrement importants : 8,6 milliards d’euros pour le FMI, 6,7 milliards pour la BCE, 15 milliards aux banques grecques. La Grèce risque donc d’être totalement asphyxiée. Dans cette situation, le gouvernement grec pourrait décider unilatéralement d’un moratoire sur le remboursement de tout ou partie de la dette pour l’année 2015, tout en indiquant qu’il serait prêt à négocier dans l’intérêt de toutes les parties.
On estime que 25 milliards d’euros ont été retirés des banques grecques entre décembre 2014 et février 2015[23]. Pour éviter une hémorragie, la question d’un contrôle des capitaux doit donc se poser. Même si celui-ci est contraire aux traités européens dont le principe de libre circulation des capitaux est un point central, la Grèce pourrait s’appuyait sur le précédent de Chypre où il avait été mis en place en mars 2013 au moment de la crise financière qui avait touché ce pays (rappelons qu’il a été totalement levé le 6 avril 2015). La BCE et la Commission avaient accepté sa mise en place car le plan de sauvetage des banques chypriotes proposé par le FMI et l’Eurogroupe avait mis à contribution les déposants, ce qui avait entrainé un retrait massif de la part des particuliers comme des entreprises. Ce contrôle des capitaux s’était d’autre part accompagné d’un plan d’ajustement structurel d’une brutalité féroce, ce qui serait inacceptable pour la Grèce. Il faut noter que Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe, a lui-même évoqué la possibilité d’un contrôle des capitaux le mercredi 18 mars sur la radio néerlandaise BNR. Le gouvernement grec pourrait le prendre au mot et l’instaurer en indiquant qu’il serait prêt à l’abandonner dès que l’étranglement du pays prendrait fin.
Un des problèmes majeurs que rencontre aujourd’hui la Grèce est le manque de liquidités. Pour faire face à ses dépenses courantes, le gouvernement grec est obligé de solliciter les fonds de sécurité sociale pour que lui soit transférées des centaines de millions d’euros de liquidités. Cette situation est intenable. Une solution pour résoudre ce problème de liquidités pourrait être la création d’un moyen de paiement complémentaire ou IOU (« I owe you »), une « monnaie » dont la valeur serait garantie par les recettes fiscales. Elle « permettrait de relever plusieurs défis de court terme : relancer l’économie locale, financer les services publics de base et réduire la dette de court terme (‘‘dette flottante’’) en ne recourant plus aux marchés financiers pour la financer »[24]. Sa convertibilité au pair avec l’euro étant garantie, un tel dispositif s’apparente en fait à un prêt à court terme que les citoyen-ne-s accordent à leur gouvernement[25]. Dans la situation de la Grèce, il s’agirait alors d’un geste autant politique d’économique qui renforcerait notablement la position du pays dans les négociations. Il permettrait également de montrer au « Groupe de Bruxelles » que le gouvernement est préparé à l’éventualité d’une sortie contrainte de la zone euro.
Le gouvernement grec pourrait alors tenir le discours suivant : « nous appliquerons notre programme, nous ne voulons pas sortir de l’euro ; mais nous ne nous laisserons pas asphyxier et c’est pourquoi nous prenons ces mesures ; nous sommes prêts à discuter avec vous d’un compromis équilibré ; mais si vous voulez nous exclure de la zone euro en nous asphyxiant financièrement, ce sera votre responsabilité, pas la nôtre ». Poser cette alternative monterait la hauteur des enjeux, et une véritable stratégie du faible au fort serait mise en œuvre, au-delà de ce qui a été tenté à ce jour. Il y aurait une possibilité pour que ce bras de fer paye, ne serait-ce qu’en produisant des divisions dans le camp adverse inquiet devant la perspective d’un saut dans l’inconnu. Le résultat serait évidemment aléatoire et pourrait aboutir à une sortie de l’euro avec toutes les conséquences négatives mentionnées plus haut. Mais, en définitive, une sortie de l’euro est de toute façon préférable à la capitulation. Et ne pas en avoir peur est encore la meilleure façon de l’éviter.
Alexis Cukier – Pierre Khalfa, le 6 avril 2015.